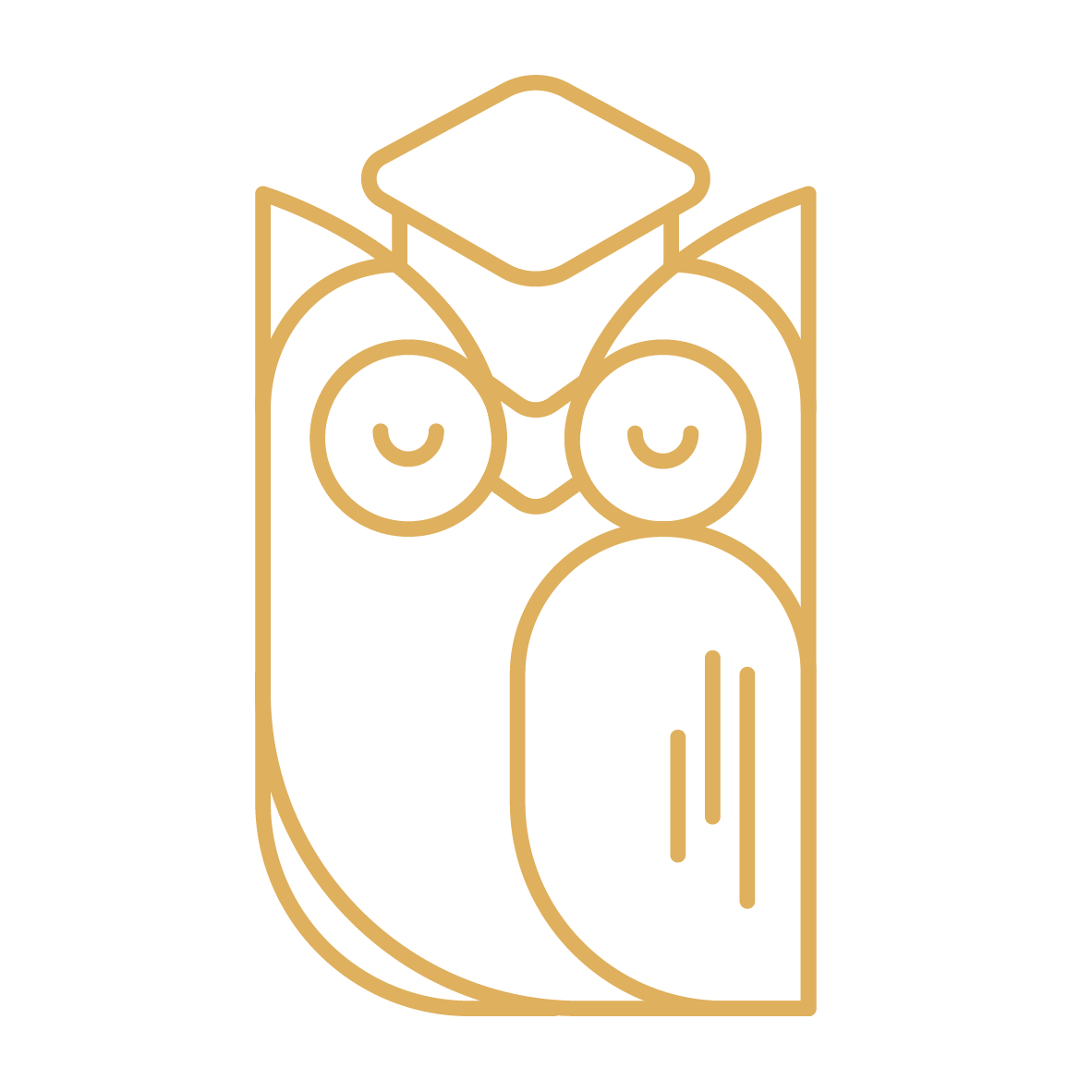
L'école de la Voie
Humain : attention, danger
Humain : attention, danger
Bonjour à toutes et à tous 👋
Bienvenue dans ce 31ᵉ cours de philosophie pratique. Que vous me suiviez depuis longtemps ou que vous veniez de découvrir ce programme, merci de votre confiance 🙏.
Aujourd’hui, nous allons aborder un sujet souvent tabou, mais essentiel. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous partager une anecdote.
Jacob, mon chat, est adorable, mais il a une [placer ici la grossièreté de votre choix] de manie.
Après s’être délesté d’un lourd fardeau dans sa litière, il devient complètement fou et se met à courir partout dans l’appartement.
Ce jour-là, je faisais de l’aquarelle, concentrée, dans ma bulle. Et puis, d’un coup, Jacob a foncé comme une fusée à travers la pièce, renversant mon matériel.
Ma chienne, Leeloo, s’est mise à aboyer, et, vous l’aurez deviné, j’ai pété un câble...
Pendant quelques instants, j’ai eu des pensées noires envers mon pauvre chat.
Après m’être calmée, j’ai réfléchi à ce moment.
Pourquoi cette colère si soudaine et intense ? Pourquoi ces idées sombres à l’encontre de Jacob, qui n’a fait que suivre son instinct ?
Cet incident m’a amenée à me questionner sur le mal qui peut sommeiller en chacun de nous.
C’est exactement ce que nous allons explorer aujourd’hui : le mal.
Ce qu’il représente, comment il s’exprime en nous et ce que nous pouvons en faire.
Au programme :
Sommes-nous si dangereux que ça ?
Plus de temps, plus de sagesse
Qui nourrissons-nous ?
Conclusion : faire du mal un allié
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez :
Découvrir gratuitementla méthode de l'école de la voie pour se reconvertir et entreprendre sur Internet
Réserver uneconsultation pour (re)trouver un sens à votre vie
Liremon livre pour vous créer une vie (presque) sans problème
Sommes-nous si dangereux que ça ?

Si vous vous demandez si, au fond, l’être humain est intrinsèquement dangereux, Thomas Hobbes vous répondrait sans hésitation : oui.
Pour Hobbes, l’homme, à l’état de nature, est un “loup pour l’homme” (homo homini lupus est).
Selon lui, en l’absence d’autorité ou de règles, nous serions tous plongés dans une guerre perpétuelle, où la survie primerait toute autre considération morale.
La violence, l’instinct de domination, et l’autodestruction seraient nos premiers réflexes. Sans lois, sans société pour nous contraindre, nous laisserions libre cours à nos pulsions les plus violentes.
Mais pourquoi Hobbes voit-il dans la nature humaine une telle tendance à la violence ?
Tout simplement parce que, pour lui, l’homme est avant tout motivé par la peur de manquer, la crainte pour sa sécurité et le désir de pouvoir.
Sans règles, chaque individu chercherait à assurer sa survie, quitte à se débarrasser des autres.
L’envie de posséder plus, d’être plus fort (toujours pour la survie) engendrerait une spirale de conflits sans fin. Hobbes a résumé cette idée dans sa célèbre formule : bellum omnium contra omnes, “la guerre de tous contre tous”.
Sans aller dans la fiction qu’est l’état de nature, il suffit de regarder l’histoire des sociétés humaines.
Des guerres tribales aux conflits mondiaux, la violence semble être un trait récurrent de notre évolution.
Quand il n’y a pas d’autorité ou de règles suffisamment fortes pour encadrer notre comportement, l’histoire nous montre que les individus – ou les groupes – finissent souvent par s’entredéchirer.
Cependant, (et heureusement) tous les philosophes ne partagent pas cette vision si sombre de la nature humaine.
Jean-Jacques Rousseau, par exemple, postule que l’homme est, à l’origine, bon.
Selon lui, l’homme à l’état de nature vit dans une harmonie relative avec son environnement et ses semblables. Ce n’est que la société qui le corrompt, le poussant à la compétition, à la jalousie, et à la méchanceté.
Pour Rousseau, c’est l’accumulation des richesses et la création des inégalités sociales qui provoquent les violences que nous voyons dans le monde.
Autrement dit, l’homme est dénaturé par la civilisation, pas naturellement mauvais.
Alors, qui a raison ?
Rousseau, avec sa vision plus optimiste de l’homme, ou Hobbes, avec son pessimisme radical ?
Pour ma part, je me range du côté de Hobbes.
Je pense que cette vision, aussi difficile soit-elle à accepter, contient une part de vérité profonde sur nos instincts.
Les recherches contemporaines en psychologie évolutionnaire montrent que nos cerveaux sont programmés pour la survie.
Face à la peur et à l’incertitude, nos premiers réflexes sont souvent la méfiance et la défense, même au détriment des autres. Ces instincts primaires, hérités d’un passé lointain, sont toujours présents en nous.
Nous n’avons qu’à observer certaines réalités modernes pour constater que la violence n’est jamais loin. Que ce soit dans les conflits internationaux, les actes de terrorisme, ou encore les violences sociales ou conjugales…
L’homo sapiens que nous sommes, semble régulièrement céder à ses pulsions destructrices.
Dans des environnements sans lois ou en période de crise, nous voyons encore des comportements qui rappellent cette nature violente qu'Hobbes décrit. L’effondrement social temporaire après des catastrophes naturelles, où le pillage et l’agression prennent le dessus, en est un exemple frappant.
Ce n’est pas pour autant une condamnation irrémédiable de l’homme.
Mais cela montre que, dans certaines circonstances, nous pouvons vite redevenir ces “loups” que décrit Hobbes. Et encore, ce n’est pas très sympa pour les loups.
Alors, si cette nature violente est toujours présente en nous, cela signifie-t-il que nous sommes condamnés à vivre sous le joug de nos instincts primaires ?
Ou avons-nous, au contraire, la capacité de nous élever au-dessus de ces pulsions ?
Plus de temps, plus de sagesse

À mesure que les conditions de vie s’améliorent et que le monde semble devenir plus sûr, nous sommes tentés de croire que l’humanité devient plus sage.
Après tout, si les taux de criminalité baissent, si les guerres sont moins fréquentes (du moins sur certaines parties du globe), ne devons-nous pas en conclure que nous avons appris à mieux nous comporter ?
C’est une idée séduisante : l’évolution technologique et sociale apporterait, avec elle, une évolution de notre conscience morale.
Mais est-ce vraiment le cas ? Sommes-nous devenus plus sages? Ou simplement plus disciplinés ?
Pour répondre à cette question, il faut d’abord comprendre que l’amélioration des conditions de vie, que ce soit par la technologie ou les lois, ne signifie pas nécessairement une amélioration de la sagesse humaine.
La baisse des crimes ou des violences n’est pas forcément due à un changement moral profond, mais plutôt à une meilleure gestion de nos pulsions, par la coercition et le contrôle.
C’est là qu’intervient Sigmund Freud avec son œuvre Le Malaise dans la civilisation.
Freud ne croit pas en une nature humaine qui se perfectionne avec le temps. Selon lui, les pulsions violentes et destructrices restent enfouies en nous, et la civilisation ne fait que les refouler.
En d’autres termes, nous ne devenons pas plus sages. Nous apprenons à réprimer nos pulsions sous le poids de règles sociales et de normes qui se sont renforcées.
Ce refoulement peut parfois nous donner l’illusion de sagesse, mais il ne s’agit que d’une adaptation à des contraintes extérieures, pas d’une véritable transformation intérieure.
Une sagesse par la peur.
Freud va encore plus loin en suggérant que ce processus de refoulement crée un malaise, une tension constante entre nos désirs et les exigences de la société. L’humain est donc coincé dans une sorte de contradiction permanente : il doit contenir ses instincts pour vivre en société, tout en étant profondément frustré de ne pouvoir les exprimer librement.
En bref, nous ne sommes pas devenus sages, mais simplement plus conscients des limites imposées par la civilisation.
Cela peut se vérifier empiriquement.
Par exemple, les statistiques montrent une baisse générale des crimes violents dans certaines régions du monde. Pourtant, cette diminution n’est pas seulement le signe d’une sagesse accrue, mais aussi d’une surveillance accrue.
Caméras de sécurité, technologies de surveillance, renforcement des lois, augmentation des peines : tout cela contribue à restreindre les comportements violents. Ce sont des forces extérieures qui régulent notre comportement, pas une sagesse intérieure qui aurait émergé naturellement.
Nous vivons dans un environnement où la transgression est plus difficile et plus risquée, mais cela ne signifie pas pour autant que nos instincts primaires ont disparu. Ils sont simplement mieux canalisés.
In fine, il est difficile de prétendre que l’humain devient plus sage avec le temps.
Au lieu de cela, nous apprenons à nous conformer à des normes toujours plus strictes, qui permettent de contenir nos pulsions, que ce soit la loi ou le jugement des autres, le “qu’en dira-t-on”.
La civilisation n’élimine pas la violence qui sommeille en nous, elle l’enferme derrière des barreaux invisibles. Nous ne sommes pas plus sages, nous sommes plus disciplinés.
Mais alors, si nous ne devenons pas plus sages avec le temps, comment devons-nous gérer les forces contraires qui s’affrontent en nous, entre le bien et le mal ? Comment pouvons-nous apprendre à nourrir nos meilleures aspirations sans pour autant réprimer violemment nos instincts ?
Qui nourrissons-nous.?

Chacun de nous porte en lui une dualité essentielle : le Bien et le Mal, Eros et de Thanatos, Apollon et Dyonisos, l’Ordre et le Chaos, le Ying et le Yang, le côté Clair et Obscur de la Force, la magie Blanche et la magie Noire (je peux continuer longtemps comme ça…).
Que faire de ces deux forces qui se battent en nous ?
La réponse classique serait de les contrôler, de réprimer ce qui est considéré comme mauvais.
Platon, illustre ça dans l’allégorie du cocher. Le cocher représente l’intellect, essayant de guider deux chevaux, l’un symbolisant les passions nobles et l’autre, les passions “basses” et dangereuses.
Tout au long de notre histoire, nous avons cherché à faire taire ces passions que nous jugeons mauvaises, à les refouler et à les écraser pour maintenir l’ordre.
Cependant, cette approche ne fait qu’entretenir la frustration et le conflit interne.
L’idée de contrôler par la force tout ce qui est perçu comme négatif est-elle vraiment la solution ?
Et si, au lieu de chercher à éliminer ces passions, on essayait de les apprivoiser ? Ces forces sombres qui sommeillent en nous font aussi partie de notre humanité.
Les réprimer ne les fait pas disparaître, bien au contraire. Elles se tapissent dans l’ombre, prêtes à surgir quand nous baissons la garde. Parce que nous amoindrissons également une partie de notre être.
Cette idée de réconciliation avec nos pulsions est mieux exprimée par Spinoza, qui propose une voie différente.
Chez lui, il y a deux grandes passions principales. Les passions tristes (haine, jalousie, ressentiment) et les passions joyeuses (amour, épanouissement, joie). Plutôt que de freiner les passions tristes, il suggère de renforcer les passions joyeuses.
En d’autres termes, plutôt que de s’épuiser à combattre le mal en nous, nous devrions nourrir ce qui est bon et constructif. C’est en développant nos passions joyeuses – l’amour, la curiosité, la créativité – que nous réussirons à trouver un équilibre intérieur.
Plus nous donnons de place à ces passions, moins il en reste pour les passions destructrices.
Mais comment faire ?
La première étape consiste à reconnaître que ces forces opposées font toutes deux partie de vous. Il n’est pas question de renier le mal qui existe en vous, mais de ne pas lui donner la pleine maîtrise.
Apprivoiser vos instincts ne signifie pas les laisser vous dominer, mais plutôt les intégrer de manière saine dans votre vie. Lorsque vous êtes confrontés à des émotions négatives, il est important de ne pas les refouler, mais de les comprendre et de voir comment elles peuvent être transformées en quelque chose de positif.
Prenons l’exemple de la colère.
Vous vous êtes disputé avec votre partenaire de vie parce qu’il ou elle n’a pas fait la vaisselle. Cela vous met en colère. Plutôt que de chercher à la réprimer à tout prix, écoutez-la et comprenez ce qu’elle a à vous dire.
Elle peut indiquer un besoin non satisfait, une frustration. Peut-être, ressentez-vous un manque de respect ou de reconnaissance de la part de votre moitié.
En l’acceptant et en la comprenant, vous avez la possibilité de la transformer en action constructive, au lieu d'une violence inutile : une communication au sein de votre couple.
En cultivant des passions joyeuses – l’altruisme, la création, le lien avec autrui – vous renforcez le bien en vous, et réduisez la place laissée au mal.
Vous nourrissez celle qui contribue à votre épanouissement. La lutte intérieure est inévitable, mais vous pouvez choisir quel côté voulez-vous voir grandir.
Conclusion : Faire du mal un allié
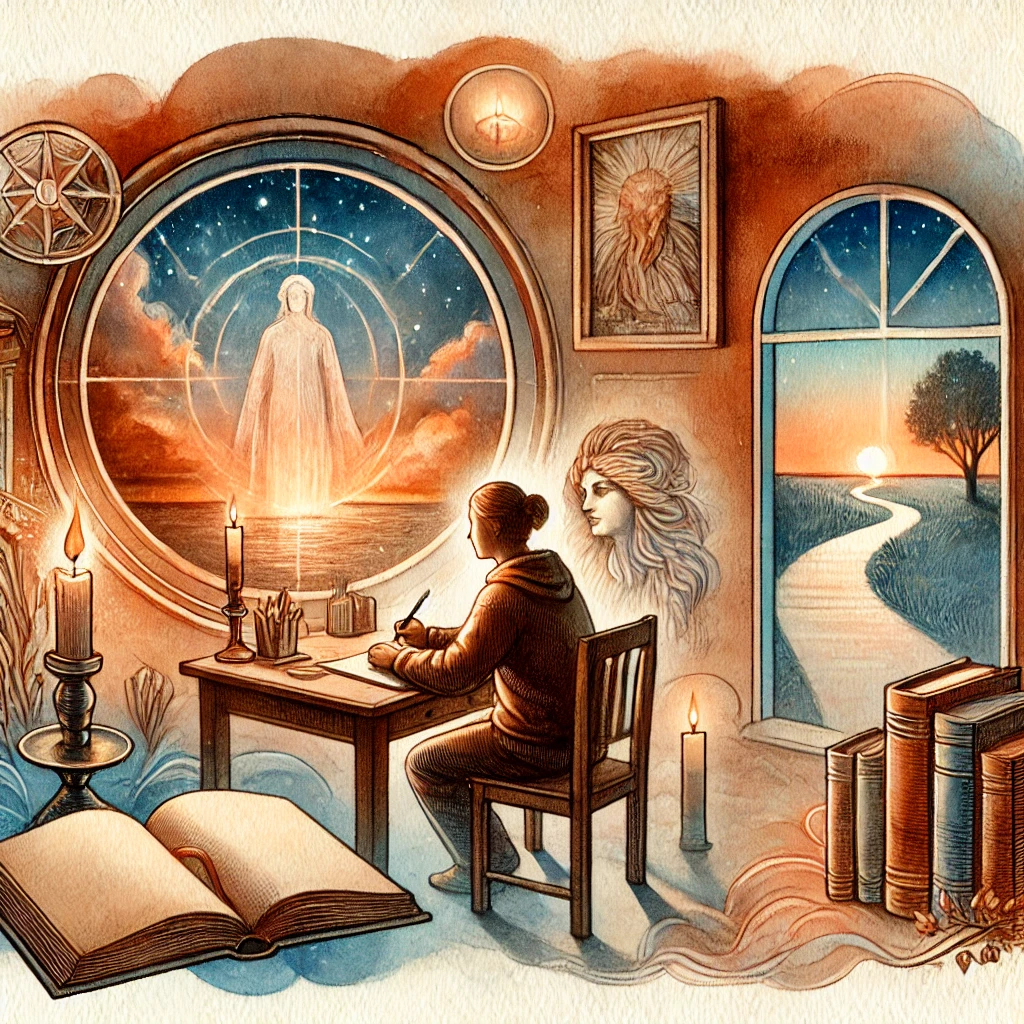
Nous l’avons dit, le mal fait partie intégrante de notre condition humaine. Il serait naïf (voire, dangereux) de penser que vous pouvez vous en débarrasser.
Qu’il s’agisse de colère, de jalousie, ou de pulsions plus sombres, ces forces existent en chacun de vous. Mais cela ne fait pas de vous des monstres, parce que le mal n’est pas seulement une menace à réprimer ; il peut aussi être une source de transformation.
En apprenant à accepter cette part d’ombre, vous êtes mieux équipés pour cultiver des émotions et des actions qui vous élèvent. La colère peut vous aider à combattre les injustices ou vous défendre.
Il ne s’agit pas de choisir entre le bien et le mal, mais de trouver un équilibre.
Renforcez vos passions joyeuses. Apprivoisez vos pulsions négatives. Crééez-vous un chemin plus harmonieux, où le bien prend de plus en plus de place.
Vous commencez par vous, mais c’est la société entière qui en bénéficiera.
Place à la pratique.
Exercice 1 : Dialoguer avec son ombre
Prenez un moment pour vous poser, au calme. Fermez les yeux et concentrez-vous sur une émotion négative que vous avez ressentie récemment (colère, frustration, jalousie, etc.).
Visualisez cette émotion comme une partie de vous, mais qui a une voix propre. Engagez un dialogue intérieur avec elle.
Que vous dit-elle ? Pourquoi est-elle apparue ? Essayez de comprendre son origine et son rôle dans votre vie.
L’idée n’est pas de la juger, mais de l’écouter. À la fin de cet exercice, demandez-vous comment vous pourriez transformer cette émotion en quelque chose de constructif.
Exercice 2 : Cultiver les passions joyeuses
Faites une liste des choses qui vous apportent de la joie et vous mettent dans une haute énergie.
Passer du temps avec vos proches, lire, faire du sport, ou créer quelque chose. Peu importe.
Engagez-vous à intégrer au moins une de ces activités chaque jour dans votre routine.
En renforçant ces moments de bonheur, vous donnez de moins en moins de place aux émotions destructrices.
Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez :
Découvrir gratuitementla méthode de l'école de la voie pour se reconvertir et entreprendre sur Internet
Réserver uneconsultation pour (re)trouver un sens à votre vie
Liremon livre pour vous créer une vie (presque) sans problème
Abonnez-vous à la Lettre de la Voie et recevez gratuitement mes meilleurs conseils pour trouver votre voie grâce à la philosophie pratique.

© www.ecoledelavoie.com